– J’y vais.
Paul se dirige le long du grillage où nous pendons nos affaires. Il ramasse son sac et demeure là. Immobile. Tanguant fragilement devant ce mur des lamentations improvisé.
– Hé Paul, ça ne va pas ?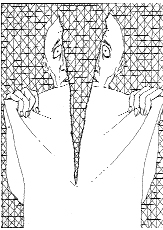 – Si, si, tout va bien…
– Si, si, tout va bien…
Il s’ébroue comme s’il tentait de se défaire de l’étreinte d’un cauchemar qui lui serait tombé sur le râble par surprise.
– Bon j’y vais
Par réflexe, se sentant trébucher, il s’est rattrapé au vocabulaire de la surveillance panoptique.
« J’y vais. »
« Je rentre. »
« Je monte. »
« Je vais voir la chef. »
« Je vais au socio, à l’infirmerie, au sport »…
Les mots de tous nos jours. De la banalité accablante. Solitude. Comme s’il fallait sempiternellement donner une explication aux autres qui pouvaient nous voir. Une raison de partir. D’arriver. De mettre sa veste. De porter un jeans au lieu de la tenue sportive obligatoire.
Dans l’expérimentation carcérale de la centrale d’Arles où le surveillant disparaît des coursives, nous nous croyons dans l’obligation de commenter nos errances quotidiennes aux autres prisonniers.
[Le modèle Panopticon de Bentham] a posé le principe que le pouvoir devait être visible et invérifiable.
Visible : sans cesse le détenu aura devant les yeux la haute silhouette de la tour centrale d’où il est épié.
Invérifiable : le détenu ne doit jamais savoir s’il est actuellement regardé.
Mais il doit être sûr qu’il peut toujours l’être.
(Michel Foucault).
Le pouvoir.
Les miradors blindés bien évidemment.
Les caméras et les interphones de la surveillance électronique…
Mais le pouvoir se soupçonne dans l’examen des autres.
Les détenus participent au Panopticon actuel. L’ombre menaçante de la tour de surveillance se reflète dans la pupille de celui qui nous voit ou qui peut nous voir.
Invérifiable fiabilité du congénère, nous te suspectons du pire.
Qu’importe ton uniforme bleu nuit ou le simple habit du semblable.
Nous épies-tu ?
Traître ?
Ou agent de la norme examinée ?
Solitaire guetteur qui attend de l’autre sa réponse.
Aux matins tôt des week-ends, un petit Arabe, un peu simple, aimait à faire les cent pas dans le couloir.
– Tu as parloir, poto ? Il n’attendait pas la réponse devant l’évidence du prisonnier vêtu de propre et poursuivi d’effluves de parfum à haute dose. Alors bon parloir, poto !
Il n’avait jamais de visites, pensait-il ainsi participer à nos visites hebdomadaires ?
Ou se donnait-il le rôle de celui qui raconterait aux autres qui était parti ou non au parloir ?
Nous essayons de riposter avant que l’interrogation ne soit formulée. Il serait louche de disparaître sans donner le mot de passe. D’ailleurs celui qui traîne sans accomplir le rite des codes devient rapidement suspect. Certains causent déjà derrière son dos. Par besoin ou par commodité, nous ne faisons rien à l’insu des autres.
« C’est plus clair ainsi. »
Rien ne doit être bizarre.
Rien d’incompris.
Tout partagé.
Fifi attendait derrière la grille.
– Putain, où étiez-vous ? On vous cherche depuis un quart d’heure. Vous savez, il faut nous dire quand vous vous en allez. On sait pas ce qu’il peut arriver.
Si on glissait dans l’escalier, si un malade nous agressait, si on se battait avec un mec pour un mot de travers ou pour que dalle, si une équipe de surveillants nous baluchonnait vers une prison lointaine, au fin fond de la détention ils seraient au courant dans la minute suivante.
Par le tam-tam de l’épidémie et du bouche-à-oreille.
Pourtant il faut donner son quota d’informations à la bête affamée...
Savoir. Vérifier.
Est-il comme nous ?
Pareil ?
Identique.
Répliquant.
Fait de sang et de peurs.
De vérités et de secrets menteurs.
Un frère ?
Frères absents de la côte. Boucaniers privés de flibuste. Pirates sans radeau. Tortue ensablée et rhum en baba. Cocotier de la vigie où se pendit le dernier des malheureux. Mardi de la semaine dernière. Sa dernière semaine.